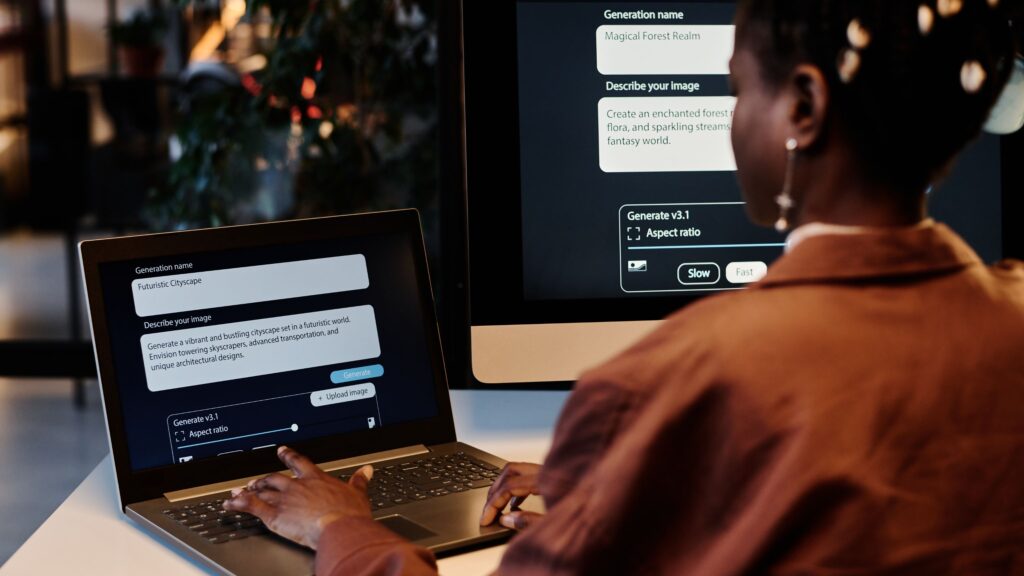
À partir de fin mai 2025, Meta (maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp) utilisera les données des utilisateurs européens pour entraîner ses systèmes d’intelligence artificielle, notamment Meta AI et ses modèles linguistiques comme Llama. Cette nouvelle a suscité de vives réactions en Europe, où les utilisateurs seront prochainement informés de leurs droits, notamment de la possibilité de s’opposer à l’utilisation de leurs données. Mais qu’en est-il pour les utilisateurs africains ?
L’ambiguïté autour du sort des données des citoyens africains
En Europe, les données utilisées incluront notamment les publications publiques (textes, photos, commentaires), mais aussi les échanges avec des outils IA comme les chatbots. Ces données, passées ou futures, serviront à affiner les modèles d’intelligence artificielle de Meta. Lancé en 2024, le projet avait été suspendu en raison des exigences formulées par l’autorité irlandaise de protection des données et ses homologues européennes, portant sur la base légale de traitement des données, la transparence et la garantie des droits des utilisateurs (personnes concernées). Ce dialogue entre Meta et les autorités européennes a été fructueux puisque les utilisateurs européens adultes peuvent d’ores et déjà s’opposer (exprimer leur refus) au traitement envisagé, conformément au RGPD. En revanche, la consultation de la politique de confidentialité de Meta relative à l’IA générative pour les utilisateurs situés sur le continent africain révèle qu’aucune option d’opposition à un tel traitement de leurs données n’est proposée. De plus, les bases juridiques invoquées pour la collecte de données en dehors de l’Europe et du Royaume-Uni demeurent floues. Meta se contente d’évoquer une « base juridique adéquate » selon les juridictions, sans fournir de précisions adaptées à chacune d’elles. Il existe ainsi une nette disparité de traitement entre les utilisateurs européens (y compris du Royaume-Uni) et ceux des autres régions du monde, notamment l’Afrique.
Les inégalités vis-à-vis de l’Afrique
Tout d’abord, la politique de confidentialité en Europe a récemment été mise à jour (entrée en vigueur le 27 mai 2025) pour intégrer les enjeux liés à l’IA, tandis que celle régissant les utilisateurs africains n’a pas été modifiée depuis novembre 2024. Cette absence d’actualisation soulève une sérieuse question de transparence. Deux scénarios possibles en découlent, chacun présentant un risque de traitement discriminatoires à l’égard des utilisateurs africains.
Le premier scénario, peu probable, serait que l’Afrique soit exclue de l’utilisation des données de ses citoyens pour l’entraînement des systèmes d’IA de Meta. Si tel était le cas, il est légitime de s’interroger sur la représentation des données africaines dans ces modèles , une sous-représentation pouvant générer des biais discriminatoires.
Le second scénario, plus préoccupant, est que Meta utilise bel et bien les données africaines pour l’entraînement de ses modèles, tout en refusant de consulter les autorités locales sur les droits fondamentaux des citoyens ou de permettre à ces derniers de s’opposer à ce traitement. Accorder ce droit à certaines régions tout en le niant aux utilisateurs africains soulèverait une grave problématique d’iniquité et de respect des droits fondamentaux.
En privant les utilisateurs africains de la possibilité de s’opposer à l’utilisation de leurs données, Meta instaure un déséquilibre de traitement dépourvu de toute justification juridique valable. Pourtant, le respect du consentement libre, éclairé et spécifique constitue une exigence fondamentale dans toutes les grandes doctrines de protection des données, notamment l’article 13 de la Convention de Malabo, et de nombreuses lois nationales africaines. Il est donc impératif de lutter simultanément contre la sous-représentation des données africaines — pour éviter les biais discriminatoires dans les systèmes d’IA et de garantir pleinement le respect des droits fondamentaux des utilisateurs du continent. L’équilibre à atteindre réside dans la véritable autonomie informationnelle laissée aux individus, quel que soit leur lieu de résidence. Cependant, en pratique, cette autodétermination ne pourra devenir une réalité concrète pour les citoyens africains que si des cadres législatifs contraignants sont mis en place et effectivement appliqués aux plateformes numériques , en particulier à des acteurs majeurs tels que Meta.
Les faiblesses de l’Afrique face à Meta
Ce traitement différencié résulte d’un manque d’influence des Etats africains face aux géants du numérique. En Europe, Meta a déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour diverses infractions et s’est systématiquement conformé aux décisions des autorités de contrôle ou des juridictions compétentes. En Afrique, en revanche, rares sont les actions d’envergure engagées contre la plateforme. À ce jour, seul le Nigéria a infligé à Meta une amende de 220 millions de dollars, une sanction que la société conteste, mais qui a été confirmée par le tribunal nigérian de la concurrence et de la protection des consommateurs le 25 avril 2025. Reste à observer comment Meta réagira face à cette sanction, d’autant que le marché nigérian est considérable : en 2025, le pays compte 237 millions d’habitants. Pour le reste des pays africains, en particulier les plus petits, le combat face à Meta semble difficile. Il est néanmoins évident qu’une réglementation continentale solide fait cruellement défaut. À ce jour, l’Afrique dispose de plus de 40 législations nationales sur la protection des données personnelles.

Bien que ces textes garantissent des droits comme le droit d’opposition et posent des principes essentiels tels que la licéité et la transparence, leur efficacité demeure largement limitée. Cette inefficacité s’explique principalement par l’absence d’autorités de contrôle véritablement opérationnelles et par la faible influence économique de chaque marché national pris séparément. Cette fragmentation législative réduit considérablement le poids collectif du continent face aux géants du numérique. La Convention de Malabo, censée harmoniser la protection des données en Afrique, peine à produire des effets concrets. Et pour cause : même après son entrée en vigueur en juin 2023, elle ne s’applique qu’aux 16 pays l’ayant effectivement ratifiée, limitant ainsi sa portée et son impact.
L’urgence d’un cadre légal harmonisé au niveau continental
L’exemple de Meta illustre, une fois de plus, l’existence d’une protection des données à deux vitesses : proactive et transparente en Europe, opaque et permissive en Afrique. Il est urgent que les États africains unissent leurs voix et adoptent un cadre juridique commun, clair, et véritablement contraignant, qui soit respecté par l’ensemble des acteurs du numérique, quels que soient leur taille ou leur pouvoir économique. Seule une approche coordonnée et ambitieuse permettra de garantir aux citoyens africains les mêmes standards de protection que ceux dont bénéficient les utilisateurs d’autres continents. L’intelligence artificielle façonnera notre avenir — encore faut-il qu’elle le fasse dans le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens, sans exception. L’Afrique ne doit pas être la zone grise du numérique mondial : elle doit être un espace où la souveraineté numérique, les droits humains et l’équité guident l’innovation.
